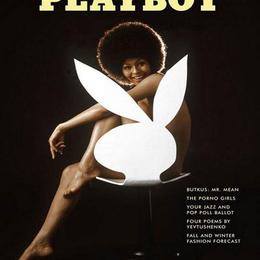Charismatique, militante, multiprimée, elle est l’une des actrices américaines les plus influentes de son époque. L’une des plus intenses aussi, comme en témoigne son nouveau rôle dans Le Blues de Ma Rainey, déjà pressenti pour faire partie des films en lice pour les Oscars et diffusé sur Netflix.
Elle est l’une des voix les plus puissantes de Hollywood, une icône afro-américaine fervente militante de la cause noire et de l’inclusion, mais sa parole est rare. Une minute d’interview, même au téléphone, suffit à le comprendre : Viola Davis ne parle pas pour ne rien dire. L’actrice star, rôle-titre du Blues de Ma Rainey, diffusé le 18 décembre sur Netflix, évite les réponses préfabriquées qu’implique souvent l’exercice promotionnel. Chaque phrase est pesée, réfléchie, pertinente, à l’image de ses choix de carrière.
Employée de maison humiliée dans La Couleur des sentiments, avocate à la moralité ambiguë dans How to Get Away With Murder, série qui assiéra sa popularité, mère sacrificielle dans Fences au théâtre et au cinéma, braqueuse par nécessité dans Les Veuves, elle endosse des rôles complexes, étoffés, nuancés, et explore des territoires multiples, au-delà de sa seule identité afro-américaine. On l’a souvent appelée la «Meryl Streep noire». Elle s’insurge, malgré son admiration pour son amie, son modèle. «J’ai une carrière probablement comparable, et pourtant je n’ai ni le même salaire ni les mêmes opportunités d’emploi, loin de là.»
En dépit de son impressionnant palmarès (deux Tony, un Emmy, un Golden Globe, un Oscar) et de son immense notoriété outre-Atlantique, l’actrice de 55 ans ne reçoit pas de propositions aussi nombreuses et variées que ses consœurs blanches. «La seule différence entre les femmes de couleur et les autres, ce sont justement les opportunités», martèle-t-elle. Sa résilience, sa détermination, sa passion restent cependant intactes.
Aujourd’hui, Viola Davis interprète dans Le Blues de Ma Rainey celle que l’on appelle «la mère du blues», pionnière trop méconnue du genre musical, chanteuse libre, bisexuelle et affranchie du joug des hommes dans l’Amérique des années 1920. Le film, adapté d’une pièce d’August Wilson, donne à voir et à entendre une autre histoire des Afro-Américains, différente de celle des livres d’école dans lesquels la petite Viola ne se reconnaissait pas. JuVee Productions, la société qu’elle dirige avec Julius Tennon, son mari depuis dix-sept ans, l’aide à suivre ce chemin, à porter la voix des autres. La sienne aussi. Celle d’une ancienne timide qui, après s’être longtemps bâillonnée, a découvert le théâtre, le cinéma, et leur capacité à élargir les horizons et à délivrer des messages, par-delà les salles.
En vidéo, la bande-annonce du Blues de Ma Rainy
Madame Figaro. – Ma Rainey (1886-1939) était une femme puissante, à l’avant-garde, sans tabou. Un rôle qui ne se refuse pas.
Viola Davis. – Absolument. Certains personnages vous apprennent une leçon, et celle de Ma Rainey est fondamentale : ce qu’elle nous dit, c’est d’embrasser notre pouvoir, quel qu’il soit. Elle défiait toute logique, tout ce à quoi la société voulait la réduire. Dans les années 1930, les Noirs, plus particulièrement les femmes, n’avaient que très peu d’autonomie. Ma était une «anomalie», une rareté. La jouer a renforcé chez moi ce besoin d’assumer ma voix.
Ne l’avez-vous pas toujours fait ?
Bien sûr que non. Quand vous êtes actrice, on vous renvoie toujours à ce que vous n’avez pas, on vous compare aux autres en insistant sur vos «manques». Et quand vous accédez à une certaine notoriété, votre image devient un objet de commentaires permanents. Il est parfois difficile de balayer cela d’un revers de la main et d’assumer ce que vous êtes, particulièrement quand vous êtes jeune. Et afro-américaine. Quand vous êtes une femme noire, actrice ou non, vous êtes «invisibilisée» par la société qui nie tout ce que vous êtes, qui ne reconnaît ni votre force, ni vos fragilités, ni votre féminité. Nos soutiens sont rares, et nous nous construisons souvent seules face à l’adversité. C’est sans doute de là que découle notre puissance : de ce que nous allons chercher dans nos tripes pour nous battre. Et c’est aussi ce qui fait ma fierté d’être une femme noire.
Ma Rainey, chanteuse corpulente, imposait une transformation physique. Comment vous êtes-vous sentie dans son costume ?
Puissante, confiante, sexy. Je suis heureuse de contrer les clichés sur les «grosses» qui, sur les écrans, sont souvent dépeintes comme des femmes rigolotes, dépourvues de sexualité et de sensualité. Je n’ai jamais compris, car dans la communauté afro-américaine, notre rapport au poids est différent. La corpulence des femmes que je connais ne les a jamais empêchées d’avoir une vie amoureuse épanouie, de s’habiller élégamment, d’assumer leur féminité. La beauté a un spectre bien plus étendu que celui qu’on lui assigne sur les écrans. Avec ce rôle, j’ai le sentiment d’avoir reconquis une partie de l’identité de femmes noires.
August Wilson, Prix Pulitzer, qui a signé la pièce à l’origine du film, est un auteur qui écrit inlassablement sur la condition des Noirs en Amérique…
Il est le gardien de notre humanité et écrit pour nous mettre en valeur. Et quand je dis «nous», je ne parle pas des quelques figures marquantes de la communauté mais des anonymes qu’il élève au rang de rois et de reines. Il rend hommage à nos rires, nos pleurs, nos quotidiens. Il appartient à la communauté noire, et aux acteurs noirs, chose que l’on peut dire de peu de dramaturges. Trop souvent, les acteurs de couleur n’ont rien à défendre. À l’instar du male gaze qui pose un regard masculin dominateur sur les femmes au cinéma, le white gaze étouffe les émotions des Noirs et tait ou caricature leurs spécificités culturelles à l’écran.
Décédée il y a 40 ans, la meneuse de la « Revue Nègre » débarque à Paris en 1925. Trois ans plus tard, l’Américaine du Missouri, qui est adulée par le tout-Paris, fait ses premières couvertures de magazines.
Cette couverture de mars 1966, avec le top afro-américain Donyale Luna, marque un tournant historique pour le Vogue britannique. Publiée également en une du Vogue France, la photo fait scandale et pousse la rédactrice en chef, Edmonde Charles-Roux, à démissionner.
Le 27 août 1967, Naomi Sims entre dans l’histoire de la mode elle est le premier mannequin noir à avoir posé en couverture du supplément mode du New York Times. Castée par l’agence Ford Models, elle fait la cover du Life en 1969.
Aux États-Unis, il n’y a pas que les magazines de mode qui s’intéressent à la beauté noire. En 1971, Darine Stern est la première afro-américaine à figurer seule en couverture de Playboy.
Un mot sur Chadwick Boseman, votre partenaire dans le film (l’acteur, révélé dans Black Panther, est décédé cet été, NDLR) ?
Très peu d’acteurs, aussi grands soient-ils, sont des artistes. Chadwick en était un. Sa foi en ce métier ne le quittait jamais. Sur le plateau, il était corps et âme dans le personnage. Observer et travailler avec quelqu’un d’aussi peu narcissique est un privilège, quelque chose de rare.
Est-il possible de mettre son ego de côté dans ce métier ?
Personnellement, je n’ai qu’une exigence : qu’on respecte mon travail. Et je crois malheureusement qu’on n’honore pas les artistes noirs comme il se doit. Si un acteur noir joue des personnages très différents qui mettent en avant l’identité noire, on le considère limité. Si un acteur blanc en fait de même avec des figures marquantes de son histoire, on salue l’étendue de sa palette. Je réclame cette même considération. Et quand arrive le moment de négocier un salaire, la taille de la loge ou la place de mon nom sur l’affiche, je ne veux pas moins que les autres. Je pense avoir gagné ce droit. Je ne me suis jamais économisée pour mon art.
Vous êtes une fervente militante de l’égalité. Vous sentez-vous investie d’une responsabilité politique ?
Shirley Chisholm, une femme politique qui a siégé au Congrès, disait : «Le service aux autres est le loyer que nous payons pour avoir une place sur Terre.» Ce prix me semble bien peu élevé au regard de ce que j’ai reçu. S’il y a une chose que j’ai apprise avec le mouvement Black Lives Matter et les élections, c’est que toutes les voix comptent. Il faut oser s’exprimer et mettre notre société face à ses contradictions et à ses injustices. Le droits d’une partie de la population sont bafoués. Nous devons le reconnaître pour évoluer.
Êtes-vous néanmoins optimiste après la défaite de Trump ?
L’espoir ne m’a jamais quittée, mais la vraie question est celle-ci : «Que doit-il se passer aux États-Unis pour que chacun puisse prétendre à la liberté et à la poursuite du bonheur portées par notre idéologie démocratique ?» Biden n’effacera pas quatre cents ans de racisme systémique en un mandat, mais il faut commencer à identifier les leviers du changement. Le premier : pouvoir utiliser sa voix sans crainte. Ce n’est ni le moment de vivre dans le silence ni le moment de rester dans sa zone de confort.
D’où vient cet engagement ?
De ma mère, de mes sœurs, des profs, des amis… Tous ceux qui ont semé des petites graines en moi, qui m’ont réveillée avec leurs mots, qui m’ont aimée ou ont misé sur moi. Shonda Rhimes, par exemple, en m’offrant le rôle-titre dans Murder, ou Denzel Washington, mon ami de vingt ans, qui produit… J’essaie d’être à la hauteur de cet amour et de cette confiance.
En vidéo, la bande-annonce des « Veuves »
Pour donner, entre autres, l’exemple à votre fille de 10 ans ?
«Le meilleur sermon est celui qui s’exprime dans les actes.» J’ai toujours essayé de vivre avec authenticité, sans tenir compte du regard qu’on posait sur moi. C’est la trace que j’aimerais laisser derrière moi, à ma fille et aux jeunes générations d’acteurs. J’ai reçu beaucoup de récompenses, mais je ne passe pas mon temps à les admirer. Elles ne font pas de moi une bonne mère ni une bonne avocate pour les causes que je défends. Je m’exprime aujourd’hui librement grâce au chemin parcouru, parce que je suis en paix avec mon passé. J’ai vécu une enfance et une jeunesse très difficiles, dans la pauvreté, la faim parfois, j’ai fait beaucoup de sacrifices en trente-trois ans de métier, ma célébrité a été tardive… Plus le parcours est semé d’embûches, plus vous devez chercher profondément en vous les outils pour survivre et vous faire entendre.
Produire est-il une façon de passer le flambeau ?
Mon mari et moi voulons trouver des talents là où personne ne regarde, décloisonner les genres et, pour être honnête, lancer des projets dans lesquels je jouerai, comme First Ladies, une minisérie de dix épisodes sur les premières dames, où j’interpréterai Michelle Obama. Nous produisons aussi The Woman King, un film de Gina Prince-Bythewood, sur une tribu de femmes guerrières du Benin au XIXe siècle. J’ai toujours rêvé de jouer dans un Braveheart noir et féminin, de mettre quelques raclées à l’écran. Je veux rendre hommage à la petite fille que j’étais. Une dure à cuire !
Le Blues de Ma Rainey, de George C. Wolfe. Sur Netflix à partir du 18 décembre.
Source: Lire L’Article Complet